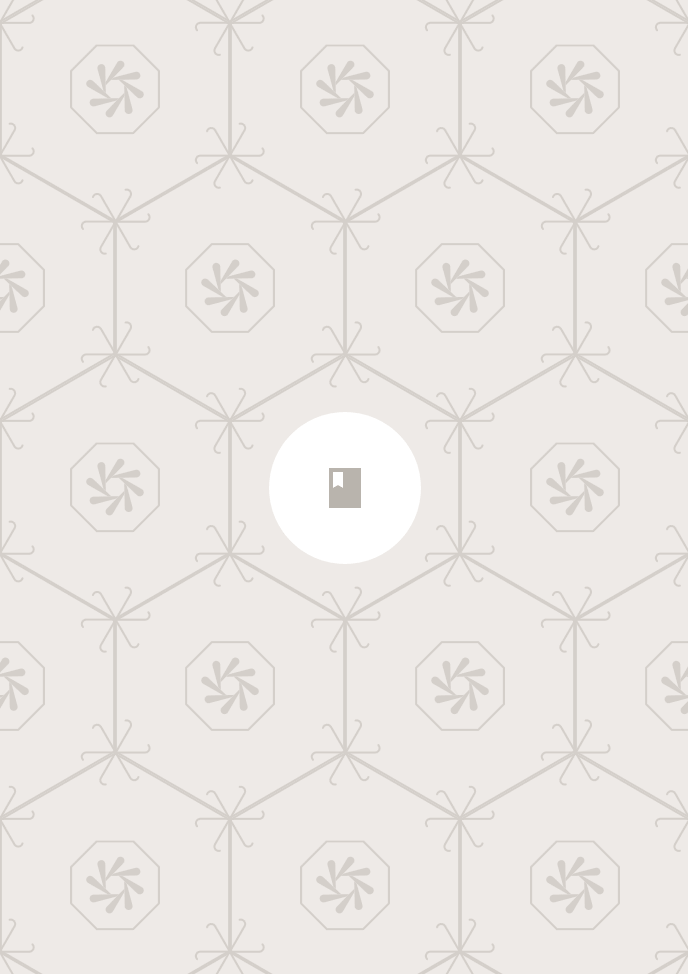Je suis né avant la première guerre mondiale, d’un papa ardéchois et d’une maman grenobloise, à Saint-Étienne, dans la Loire, une des villes les plus laides du monde. En un temps où les maladies infantiles exerçaient des ravages parmi mes contemporains, je traversai allègrement toutes embûches dressées sous mes pas si bien que lorsque la civilisation du XIXe siècle finit dans les charniers de 1914, j’étais un solide bambin qui se souvient de cette fabuleuse époque comme d’une immense inquiétude troublée seulement par les pizzicatti des sabots des chevaux de fiacre, traversée de la senteur légère « Cuir de Russie » et imprégnée de l’odeur de pain blanc. Je fis donc partie de ces gosses qui apprenaient matin après matin, la mort d’un père, la mort d’un frère, la blessure d’un oncle et d’un cousin et qui menaient leurs jeux dans l’ombre des voiles noirs des femmes veillant sur eux.
Adolescence plus ou moins sotte comme toutes les adolescences, puis le spectre d’abord lointain et chaque mois plus proche du bachot. J’habitais Nice en ce temps-là… Un Nice où l’on goûtait une merveilleuse joie de vivre… Un Nice qui a disparu avec notre jeunesse. Le bachot puis le départ pour Marseille afin d’y préparer le P.C.B. qui devait m’ouvrir les portes de la Faculté de médecine.
Mon père – qui m’avait élevé dans la conviction que je reprendrais l’Alsace et la Lorraine – m’en a toujours un peu voulu d’avoir dû se charger de cette besogne à ma place. Il me voulait officier. Heureusement une incapacité totale et rédhibitoire à dépasser le stade de la division sans décimale me sauva de Saint-Cyr. C’est alors que commença à se manifester cette longue incompatibilité d’humeur entre l’armée et moi qui devait me faire souffrir mille vexations de la part des militaires chaque fois que j’eus affaire à eux. L’auteur de mes jours, obstiné à m’imaginer sous l’uniforme, m’obligea à préparer l’École de Santé militaire de Lyon. Mais un incident grave survint alors pour orienter différemment ma vie estudiantine : je fus honteusement mis à la porte de la Faculté de médecine à la suite d’un chahut où je me délassais en tentant d’oublier l’horreur irrépressible que m’inspirait la dissection des cadavres et les stages à l’hôpital.
Ne pouvant plus être médecin, ni officier de santé, je m’orientai – toujours à mon corps défendant – vers les sciences naturelles. Licence, diplôme d’études supérieures, la filière habituelle, puis la nomination comme professeur-adjoint au Lycée Henri-IV à Paris, pour y préparer l’agrégation. Cela se passait environ l’année 1932, je pense. C’est alors que je fis deux rencontres capitales : Alain qui m’enseigna le mépris des honneurs et Charles Dullin qui m’apprit à ne pas me soucier du succès. Le premier m’invita à penser, le second à rêver. Je leur en garde à l’un et à l’autre une reconnaissance qui ne finira qu’avec moi-même.
Quoique l’ayant reculé jusqu’aux extrêmes limites autorisées par la loi, il me fallut bien accomplir mon service militaire. Je le fis à Saint-Cloud dans une arme terriblement savante à laquelle je ne compris jamais rien, pas plus qu’y comprit quoi que ce soit mon cadet et ami Paul Guth, qui, en ma compagnie, savoura les servitudes militaires dans une armée encroûtée dans le passé et où l’adjugent Flick régnait encore en maître. Pour comble d’infortune, j’eus droit au 6 février 1934 et fus à moitié occis le lendemain – en tant que serviteur de l’ordre – par un Algérien qui manifestait l’étrange idée de me chiper mon mousqueton. Je terminai mon temps de service sous les drapeaux comme simple soldat et le souvenir d’innombrables nuits de garde – qu’en dépit des années passées, et au contraire de mes contemporains qui, entre deux tournées d’apéritifs, soupirent : « C’était le bon temps » - je ne me le rappelle pas avec plaisir.
Réintégrant l’Université, je repris sans tellement de conviction la préparation de l’agrégation, mais une interrogation écrite de sept heures sur des pachydermes fossiles qui n’étaient plus des mammouths et pas encore des éléphants, m’ôta toute espérance de finir dans la peau d’un professeur. Loin de me désespérer, je me félicitai de l’aventure et je me jetai dans le théâtre en me berçant de belles illusions quant aux années immédiatement à venir. C’était compter sans un nommé Hitler…
Bien qu’aux avant-postes de l’armée française, j’eus la chance de n’être pas fait prisonnier et après de sanglantes péripéties, parti pour Berlin je me retrouvais à Lourdes. Un miracle en quelque sorte.
Je fis mes débuts en tant qu’auteur dramatique, à Genèvre, en la salle communale de Plainpalais où mon vieil ami Pierre Valde monta mon Aller sans retour. Nous tombâmes de compagnie sous la cabale des dévôts ! Du moins, c’est avec cette conviction que je pansai mes blessures d’amour-propre… Puis, au cours des années qui suivirent je fus joué sans grand succès par Marcel Herrand au théâtre des Mathurins, où un jeune acteur qui commençait à se faire un nom tenait le rôle principal de ma pièce. Il s’appelait François Perrier. Puis mon Cristobal fut monté au théâtre Gaston Baty-Montparnasse et mon Annette ou La Chasse aux papillons au jeune Colombier. Côté roman, je manquai le prix Renaudot d’une voix et, après un deuxième livre publié chez Gallimard, je renonçai, n’étant pas d’un caractère entêté.
La Libération m’avait transformé en journaliste provincial et, de ce fait, je revenais au métier paternel. Éternel retour !... Le cinéma me ramena à Paris : une quinzaine de films heureusement oubliés. Résigné à ne plus essayer de frapper mes contemporains d’admiration, je vivais à la campagne avec mes chiens, mes chats, mes oiseaux, ayant pris Candide pour modèle lorsque le hasard me fit rencontrer ma chance, m’offrant ainsi une revanche à laquelle je ne croyais plus. La chance – qui sans doute voulait se faire pardonner de m’avoir si longtemps boudé – me permit de créer le roman policier humoristique.
Un beau matin (nous sommes en 1954 ou 1955) le destin frappe à ma porte en la personne d’un facteur qui me remet un mystérieux colis. Il s’agit d’un manuscrit de roman policier. L’auteur, un de mes vieux amis, habite la province. Ne sachant à quel éditeur envoyer son manuscrit, il a pensé que je voudrais bien m’en charger. Me voilà bien embarrassé ! C’est que j’ignore à peu près tout des maisons d’édition de romans policiers ! Je demande conseil autour de moi. On m’indique la Librairie des Champs-Élysées. Je m’y rends et présente le manuscrit à Albert Pigasse, le fondateur de la célèbre collection « Le Masque ». Celui-ci l’accepte, le lit et me le rend quelques jours plus tard. « Il est impubliable » me déclare-t-il franchement. Et d’exposer les raisons littéraires et techniques qui expliquent son refus. Je ne suis pas surpris. Moi non plus je ne trouve pas très réussi ce premier essai de mon ami de province. À mon tour j’émets quelques critiques particulièrement pertinentes et explique à M. Pigasse comment, à mon avis, le sujet aurait dû être traité. Tant et si bien que le directeur du « Masque » en vient à me demander pourquoi moi-même je n’essaye pas. D’abord un peu tiède, je finis par relever le gant. Et en 1957 « Le Masque » publie mon premier roman policier : Elle avait trop de mémoire.
Et maintenant, le bilan : le demi-siècle dépassé, de tout ce que j’ai pu mener à bien, de quoi suis-je le plus fier ? De mon prix du Roman d’aventures sans doute, mais aussi d’avoir été élu Président de la Fédération internationale de la Presse gastronomique et viticole. Mon violon d’Ingres ? La cuisine. L’endroit où je me sens le plus à l’aise ? Ma cave. Signe particulier : après plus de trente années consacrées aux Lettres, j’ai reçu le Mérite agricole.
Peut-être ceux qui liront cette biographie se demanderont à quoi je ressemble ? Qu’il leur suffise de savoir que je pensais neuf libres quand je vins au monde et qu’aujourd’hui j’en compte cent quatre-vingt-dix-huit de plus. Je suis d’une race qui « profite » et, sur scène, le rôle de Falstaff me conviendrait mieux que celui de Roméo.
Charles EXBRAYAT.