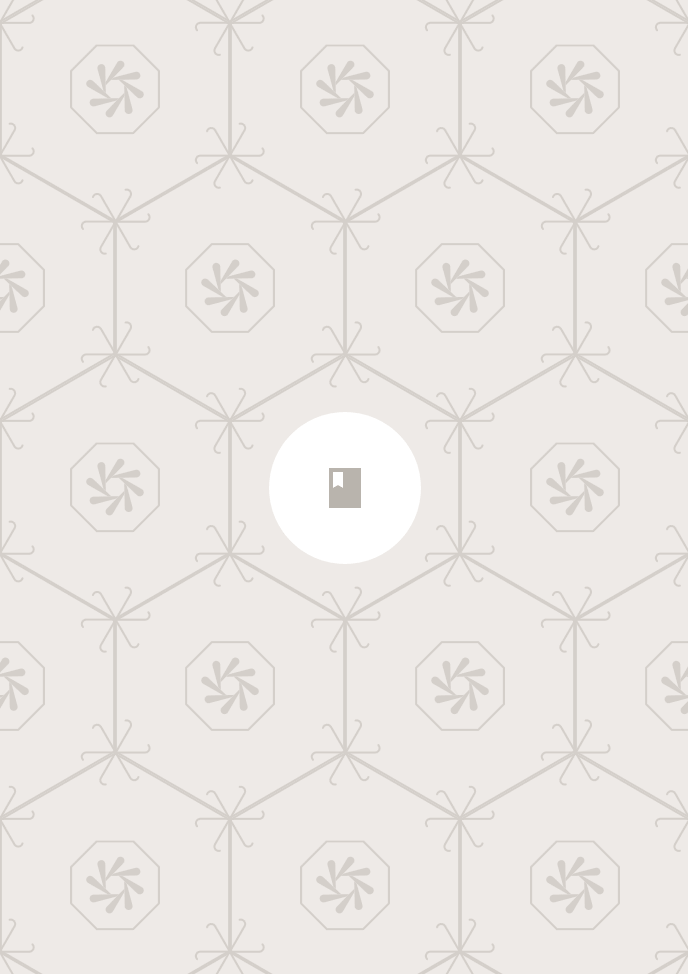Décentrer le regard
À la mort de Madame Simone, Anna ne perd pas seulement sa colocataire de soixante-dix ans, elle perd celle qui parvenait à « muer le sombre des choses en douceur domestique », celle auprès de qui elle avait reconstitué la chaleur d’un foyer. Sans cette force tranquille pour la soutenir, Anna vacille. Elle ressent d’autant plus la douleur de cet équilibre perdu que celle qu’elle pensait connaître, et dont elle aimait l’approche de la vie sans filtre mais discrète, cache en réalité une histoire dont Anna ignore tout. Prise entre « l’excitation de comprendre et l’aigreur de n’avoir rien su », la jeune femme se lance dans l’inconnu d’une quête à laquelle rien ne l’avait préparée. Jeune journaliste pigiste se noyant dans une vie où se mêlent sentiments de vacuité et d’inutilité d’être au monde, écrasée par un sentiment d’échec, honteuse de n’être qu’un « amas de petits bouts de trucs même pas rafistolés », Anna pose sur elle-même un regard sans filtre, ironique et parfois cruel. Et c’est ce qui la rend profondément attachante. Lorsqu’elle s’adresse à nous, elle crée un lien, une connivence qui nous donne envie de la suivre dans cette quête qui va ébranler ses certitudes. Entre « inconscience totale » et « optimisme radical », Anna est surtout mue par le « souci de son prochain, l’Autre, A majuscule, le pas-nous-même » qui est au cœur de sa vision du journalisme. Parce qu’elle pense tout connaître et ne connaît donc rien, mais parce qu’elle se laisse la possibilité d’être bousculée par l’inattendu et surtout l’indicible, Anna va permettre d’offrir, sur la réalité qu’elle s’apprête à découvrir, un regard décentré, qui observe sans juger. Il faut bien cela pour tenter de détricoter l’histoire de Madame Simone dont les secrets sont enfouis là-bas, en Israël. « En suspension dans cet espace inconnu » qu’une étrange invitation l’amène à visiter, Anna découvre Israël et ses réalités multiples et complexes. Mais dans ce pays défiguré par des frontières physiques et symboliques tentaculaires qui ne manquent pas d’interpeler « cette enfant de Schengen », Anna parvient à déceler la beauté et l’humanité. Déambulant dans les rues de la pittoresque Jaffa, vacillant sous le choc esthétique provoqué par les trésors cachés de Jérusalem, ou découvrant sidérée la vie à Ramallah à quelques encablures de là, Anna nous emmène avec elle dans ce voyage qui, s’il ne lui permettra pas de tout comprendre, lui offrira la possibilité de voir et ressentir ce pays qui, depuis « l’événement indicible », « secoué dans ses fondations », « tout entier pris dans sa guerre », « s’est replié dans la cuirasse de son essence et de ses habitués ».
L’infini nuancier de l’humanité
Si son voyage-enquête l’ébranle dans toutes ses certitudes, Anna reste convaincue d’une chose : le Bien et le Mal n’existent pas et « la morale est mobile ». Dans ce conflit protéiforme, chacun peut être à la fois victime et bourreau, la haine devenant « cet endroit bien confortable où l’on se sent appartenir ». Ses connaissances aigües et intimes des lieux et de leurs histoires et son expérience de la vie au cœur de ce maelström géopolitique permettent à Marie Semelin de donner à sa fiction une profondeur sensible et érudite. Ainsi, en remontant, aux côtés d’Anna, le fil de l’histoire de Madame Simone, ce sont des pages entières et méconnues d’Israël que l’on découvre. Dans ce pays morcelé où cohabiter est autant une obligation qu’une nécessité, la réalité n’est jamais ce qu’il paraît. L’espoir trahi des Mizrahim, Juifs d’origine irakienne, marocaine ou turque, « attirés sur de fausses promesses de l’Eretz Israël » et relégués à la marge car jugés « primitifs ». Le stress post-traumatique des jeunes soldats israéliens, « reste d’armée cabossés (…) qui se retrouvent misérables vivants avec rien d’autres qu’eux-mêmes », leurs peurs se fondant dans celle des victimes innocentes qui meurent de leur main guidée par un pouvoir aveugle. La vie en sursis des Palestiniens de Cisjordanie, victimes d’un système arbitraire qui transforme leur quotidien en une incarcération sans fin. Le quotidien des déplacés Israéliens « vivotant dans des logements temporaires réquisitionnés par le gouvernement » depuis le 7 octobre. Le « paysage de cratères délavé » qu’est devenu Gaza. L’identité fragmentée des « Arabes israéliens » qui préfèrent les termes « Palestiniens de 1948 » ou « Arabes d’Israël » leur permettant « une contestation discrète de l’absorption nationale ». La vie des humanitaires et journalistes entre sacerdoce et sacrifice. L’entente complexe entre Israéliens et Juifs ultra-orthodoxes que leur vision de la vie oppose diamétralement… Tous ces sujets abordés dans le roman sont autant de teintes qui composent « l’infini nuancier » qu’est Israël, ce mystère dont personne ne peut prétendre détenir la clé, à l’exception peut-être des enfants. En retraçant la destinée tragique de Madame Simone, on remonte le temps jusqu’à la Jérusalem des années 1950 dont les frontières, « dessinées au gros feutre » par des puissances ignorant délibérément ou non la spécificité des identités et des cultures, ont créé un no man’s land que seuls les enfants osent occuper. « Se reconnaissant semblables », car partageant les mêmes déchirures, les mêmes blessures « du déracinement, du deuil, de la pauvreté et de la faim », les enfants se permettent des incursions en terrain ennemi, laissant à leurs cœurs la possibilité de s’ébrouer au rythme d’un même espoir de paix que seule la folie des adultes réduira en miettes. Mais sous les cendres de ces rêves brisés, sous « cette violence contenue qui turbine sous la terre », sous « cette lave mijotant à feu doux avant déflagration », subsistent les soubresauts à peine perceptibles mais pourtant bien présents d’une humanité jadis partagée.
Juliette Courtois
© Marie Rouge