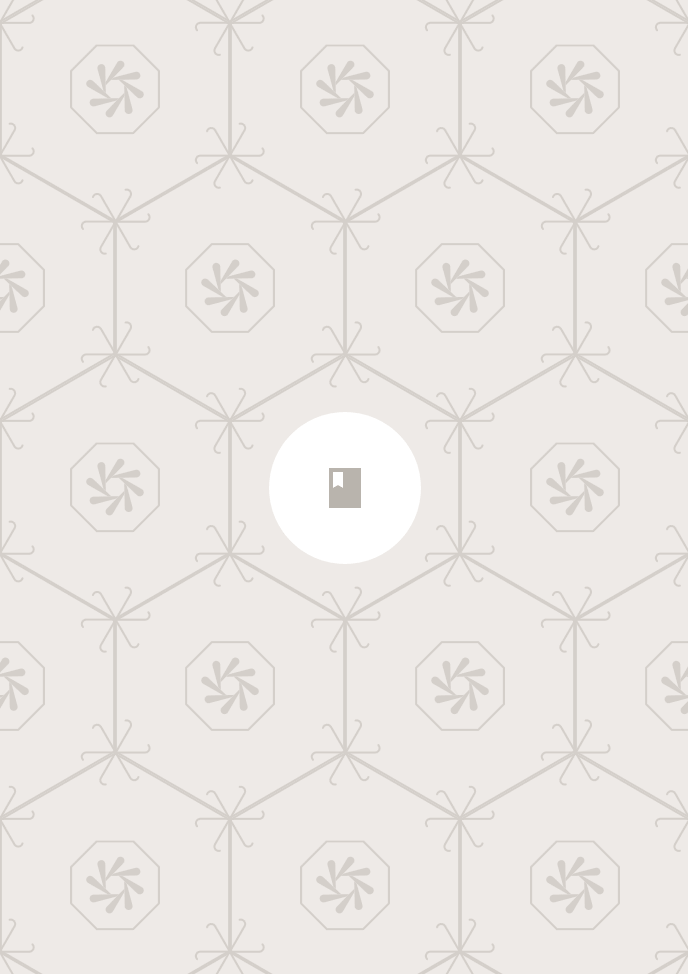Chasse aux fantômes
Une photo, une simple photo, et c’est « la vie qui vacille devant l’inconnu ». Comment Beatriz Reimann ne pourrait pas être troublée par ce petit bout de papier qui exhale « un vent glacial tout droit venu de l’Allemagne nazie d’autrefois » ? Sur cette photo, elle reconnaît Hitler, Werner Heisenberg, Prix Nobel de Physique, et… son père, Karl Holtzinger, puissant homme d’affaires suisse qui fit fortune au Chili. Pour essayer de comprendre celui qui se présente désormais comme une équation irrésolue, pour tenter d’arracher celui qu’elle pensait connaître « aux ténèbres du silence et du secret », Beatriz Reimann demande l’aide de Daniel Zinga, écrivain, ami et amant. Analyser dans les moindres détails photos et vidéos, se plonger dans la somme astronomique d’archives désormais déclassifiées, interroger ceux qui restent et qui cachent dans leurs silences la clé de ce mystère personnel dont les contours deviennent chaque jour douloureusement plus clairs... pour les deux intellectuels, cette (en)quête n’a rien d’une sinécure, comme le prouve la beauté des lieux traversés qui cache en réalité nombre de cicatrices oubliées. Entre thriller historique et roman d’espionnage, L’équation avant la nuit est d’une grande érudition et nous fait voyager sur les routes de l’atome que se disputèrent les grandes puissances de la Seconde Guerre mondiale dans une course à la bombe qui changea le monde à jamais. Le roman interroge ainsi la place de la science dans ce maelström géopolitique, questionnant les complexes prométhéens de scientifiques pris au piège de la bataille du génie et du patriotisme, simples mortels qu’une équation menaçait de transformer en « ange des ténèbres ».
Les marges de l’Histoire
Cette course à la bombe repose toute entière sur l’extraction de l’uranium, dont les belligérants doivent sans attendre trouver de nouvelles sources d’approvisionnement. Vont ainsi se dessiner deux autoroutes de l’atome, l’une depuis le Grand Lac de l’Ours et la ville de Déline au Canada, et l’autre depuis la mine de Shinkolobwe au Katanga, région du Congo. Se mettent alors en place les rouages mortifères de l’extractivisme le plus vorace, cette « religion du colonialisme » consistant en une « exploitation massive des ressources de mère Nature ». Pillant sans vergogne les terres, l’homme occidental exploite également les populations qui les habitent. Sourdes aux croyances autochtones fondées sur l’idée que « la terre n’appartient pas aux humains, mais que ce sont les humains qui appartiennent à la terre et qu’intérioriser l’inverse revient à ajouter au malheur du vivant », les puissances occidentales ont créé les conditions de ce qui prendra, des années plus tard, la forme d’extinction pure et simple de population et d’écocide. Alors que faire de ce passé dont les conséquences mortelles ont empoisonné l’avenir de ceux que beaucoup voudraient oublier ? Parce que « la mémoire n’est pas un tribunal, mais un antidote pour le futur », il faut que chacun puisse « se raconter sans fard, ni pusillanimité, ni autocensure » et endosser les responsabilités qui sont les siennes. Mais l’Occident est-il prêt à rembourser ses dettes de sang ? Faire reconnaître ce dont ils ont été victimes relève presque de l’impossible pour ces peuples colonisés, exploités, et spoliés. Acheter un silence que des élites corrompues sont toutes prêtes à vendre semblent être la solution choisie par la majorité pour résoudre cette équation. Mais, pour que les Dénés du Canada et les Lundas du Congo, qui ont payé ce lourd tribut à une guerre qui n’était pas la leur, ne soient plus jamais réduits au silence, Blaise Ndala leur redonne une voix à travers de puissants personnages mus par la volonté de transformer la colère en force de guérison et de pardon.
L’intime et l’universel
L’équation avant la nuit est aussi un roman qui questionne la place et le rôle de l’écrivain. Blaise Ndala souligne non sans ironie les petits et grands travers de l’homme de lettres terrifié à l’idée « de finir dans le ventre bétonné de l’oubli ». Il décrit également la complexité du processus créatif et le juste équilibre à trouver entre la vie et la création, chacune nourrissant l’autre. Mais plus que tout, Blaise Ndala questionne l’identité. Peut-on n’être, comme le revendique le personnage de Daniel Zinga, qu’un écrivain tout court dont les écrits se font simplement l’écho de ses obsessions les plus intimes et de ses « vérités en recomposition permanente », faisant fi de ses origines ? Se voulant « agnostique de toute assignation », Daniel Zinga, congolais d’origine mais canadien d’adoption, refuse de devenir le « tirailleur littéraire d’une guerre mémorielle et décoloniale fantasmée ». Mais ses convictions personnelles vont être mises à mal par les femmes de sa vie, Beatriz Reimann d’un côté et sa fille Fioti de l’autre. Toutes deux poussent l’écrivain dans ses retranchements et « explorent [pour lui] les angles morts de sa psyché ». Elles lui rappellent qu’assumer sa « part africaine » ne l’éloignera pas de l’universalisme qu’il chérit tant, bien au contraire. « L’imagination d’abord, le logos ensuite demeurent des armes miraculeuses sans lesquelles il est impossible de battre l’eurocentrisme avec ses propres armes, impossible de nourrir le récit pluriversel des voix indigénisées » et pour les deux femmes, Daniel Zinga doit en faire une force pour redessiner les contours d’une identité multiple enfin assumée.
Rien n’est plus complexe que de « trouver la ligne de crête entre un art qui serait aveugle aux tensions qui traversent la société et la prise de conscience du fait que la littérature façonne les imaginaires chez ceux qui la consomment », mais avec L’équation avant la nuit, Blaise Ndala parvient à relever ce défi, offrant un roman qui bouscule et questionne, faisant tomber nos œillères pour faire jaillir la lumière.
Juliette Courtois
© Gabrielle Dallaporta