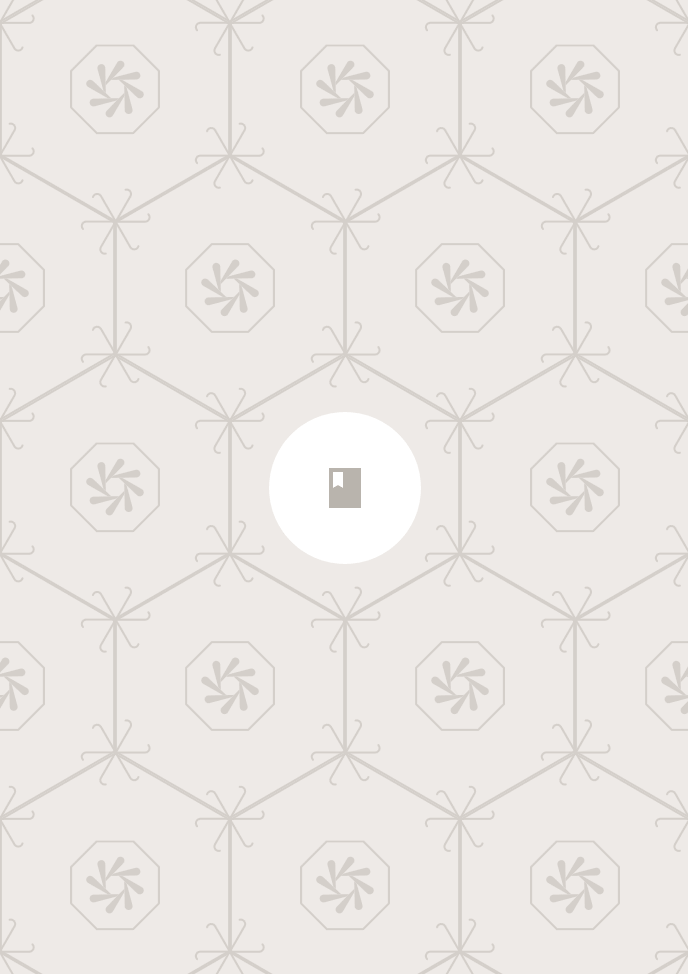Pouvoir symbolique
Lorsqu’elle enseignait à Madagascar, Hella Feki résidait à Tananarive en face de la colline sacrée où trône le Palais de la Reine. Des reines, il y en eut plusieurs. Ranavalona Ière, surnommée la « Caligula femelle », est sans doute l’une des plus célèbres. Mais c’est une autre reine qui hante Hella Feki de « son sourire lointain ». Ranavalona III est une reine à qui tout fut imposé, la contraignant à devenir, bien malgré elle, un pion au cœur des jeux de pouvoir. Les hommes la trahissent et pensent l’asservir, mais Ranavalona III conserve sur son peuple l’aura symbolique d’une souveraine dont le rôle est de faire le lien avec les ancêtres que l’on honore à travers de fastueux rituels. Le règne de la souveraine prend place en pleine période de « course aux colonies » et Madagascar se retrouve prise en étau entre la France et la Grande-Bretagne. Face à l’oppression, les révoltes s’enchaînent. Envoyé comme porteur d’une « mission civilisatrice », le Général Gallieni opère une « pacification meurtrière ». L’île est à feu et à sang, mais la cruauté du nouvel administrateur de l’île, désormais sous contrôle français, ne s’arrête pas là. Ce dernier développe une obsession pour Ranavalona III qu’il soupçonne de fomenter en secret de nouvelles révoltes. Rien ne pourrait être plus faux, mais Gallieni est prêt à tout pour réduire au silence cette reine qui le hante et l’effraie. L’exil sera sa sentence. A La Réunion d’abord, puis en Algérie. Mais ce que Gallieni ignore, c’est que « c’est dans cet exil, dans le dépouillement de son autorité que Ranavalona III conquiert son statut d’icône nationale ». Blessée par les conséquences d’une « servitude fataliste » à la force coloniale, Ranavalona III ne cessa pourtant jamais de nourrir pour sa patrie d’accueil une très contradictoire loyauté. Autorisée à voyager en métropole, elle y reçoit tous les honneurs, sans être dupe d’une adulation qui confine souvent à la caricature. Suscitant « une curiosité tantôt hostile, tantôt sensible », cette dernière souveraine de Madagascar fut la première grande vedette de la presse populaire française. Mais Ranavalona III lutta pour ne pas se laisser enfermer dans cette image d’elle que les hommes ont voulu recréer.
Mélancolie de l’exil
Sorte de journal intime d’une reine en exil, le roman d’Hella Feki est une réflexion sur l’isolement, l’arrachement à la terre des origines, l’identité morcelée. Ranavalona III prend la plume à Alger, le 23 mai 1917. Sujette aux angoisses prémonitoires, la reine sait sa fin proche, il lui faut donc, sans attendre, emprunter à rebours les chemins de sa mémoire pour que chaque souvenir marquant reste vivant. Lorsque l’on perd tous ses repères, s’ancrer profondément dans son monde intérieur devient une nécessité. Mais, « refusant que son identité soit une geôle », Ranavalona III décide de transformer son exil en une nouvelle manière d’être au monde. Au cours de ses recherches, Hella Feki découvre que la souveraine malgache fit un voyage en Tunisie. Il n’en fallait pas plus pour aiguiser l’instinct de la romancière qui vit dans cette escapade tunisienne quasi inconnue l’occasion d’imaginer la rencontre entre Ranavalona III et sa ville natale, Tunis. Relatant ses déambulations dans cette cité aux mille couleurs et senteurs, la reine dessine les contours d’un « amour-paysage ». En se laissant aller à la contemplation et à la méditation, Ranavalona III se réapproprie son corps, son cœur et son âme et s’ouvre à la possibilité de l’insolite et de l’inattendu. Ses réflexions s’appuient sur une poésie des mots, une sensualité de la langue, dont elle souligne toute la puissance et la magie, elle qui découvre que « l’écriture est peut-être ce qu’elle a hérité du chemin de l’exil ». Mais en déambulant dans les rues de Tunis, soumise à son tour aux soubresauts de l’Histoire, c’est une autre ville qui apparaît à la reine, comme en surimpression, offrant à Ranavalona III l’occasion de repenser à son île natale et au rôle qu’elle y jouât en tant que souveraine.
Souffle nouveau
A Tunis, Ranavalona III décide d’être actrice de son bonheur et « de le sculpter comme un chef-d’œuvre », s’appuyant sur les enseignements de femmes de lettres qui la fascinent et auprès de qui elle « vit ses plus belles aventures littéraires et intellectuelles », « renaissant par leurs récits plus grands que la vie ». La reine se rapproche d’abord de Myriam Harry, la plus orientale des françaises, reporter et écrivaine de renom qui remporta le tout premier Prix Femina. Par l’entremise de cette dernière, Ranavalona III rencontre la Princesse Nazli et la Reine Lella Beya Qmar. L’égyptienne et la tunisienne ont chacune à leur manière bouleversé le Moyen-Orient de l’époque créant des salons et cafés féminins où furent discutées des idées novatrices sur l’Islam, l’émancipation des femmes, l’égalité des peuples. En choisissant d’imaginer des rencontres entre toutes ces femmes, Hella Feki lutte contre leur invisibilisation, tout en mettant à mal les clichés sur la femme moyen-orientale. Une même sororité relie ces femmes qui ont fait de ces salons emplis de liberté, l’envers des sérails où elles furent captives.
A la fin de son roman, Hella Feki adresse une lettre à la dernière reine malgache pour lui dire son admiration, mais aussi pour lui avouer combien écrire sur elle fut un cheminement long et complexe. C’est d’ailleurs en écrivant cette lettre qu’Hella Feki parvient à déclencher le processus d’écriture, comme si s’opérait une sorte de passage de flambeau entre la reine en exil et l’autrice voyageuse. A l’image de sa Ranavalona III de fiction qui fonda sa renaissance sur la sororité des salons féminins, Hella Feki puise un nouveau souffle créateur dans le parcours de cette reine à qui, par la puissance de sa langue riche et poétique, elle redonne enfin un royaume.
Juliette Courtois
© Marie Rouge