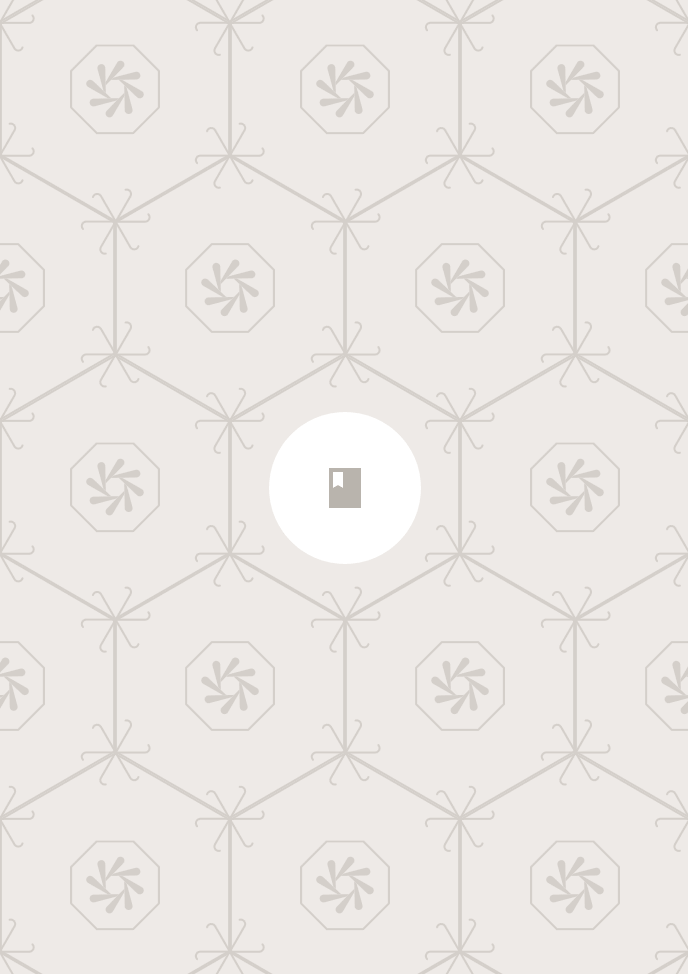Mémoire d’Irak
Parce qu’il découvre bien trop tôt et bien trop brutalement que « les puissants dictent toujours leur loi et [que] les cœurs brisés doivent se taire », Adel se donne le ciel pour horizon. Là-haut, « loin du chaos du monde », à bord « d’une des plus grandes légendes de l’aéronautique » soviétique, le MiG-21, plus personne ne pourra l’ignorer et, enfin, il pourra briser les murs que le mépris et l’ignorance ont dressé autour de lui. Adel et ses camarades deviennent ainsi les fiers représentants de ce « rêve d’indépendance et de modernité » qui porte l’Irak des années 1960. Mais très vite, ces jeunes hommes vont comprendre que ces ailes, qui leur donnaient un sentiment d’invincibilité, sont en réalité lestées de plomb. En retraçant le destin d’Adel, « ce fantôme du passé », Feurat Alani retrace aussi l’histoire tourmentée de l’Irak en asseyant définitivement son talent de conteur et de romancier. Ses connaissances érudites sur l’histoire et la géographie du pays mêlées à son expérience personnelle lui permettent de nous les restituer sans aucune pesanteur dans une fiction qui se teinte parfois des couleurs du thriller ou du roman d’espionnage. Le destin d’Adel est à l’image de son pays, sans cesse en mutation, oscillant entre « espoirs et incertitudes », pris en étau entre les rêves de puissance et de grandeur de nations qui le vampirise. De son écriture puissante et empathique, Feurat Alani nous plonge dans la tête et le cœur d’un jeune homme qui, de partout, voit les ombres surgir. Le pouvoir tisse inlassablement sa toile impitoyable prenant au piège des esprits tiraillés entre « le devoir de servir » et « la méfiance grandissante envers ceux qui prétendent incarner l’avenir ». Sans plus aucunes illusions, tentant d’échapper à la folie des hommes et à ces guerres qui « érodent les âmes » et « brisent la volonté », certains choisissent la fuite, d’autres restent et se retrouvent, malgré eux, « les pièces maîtresses d’un engrenage infernal » qui terrorise et tue. « Mais jusqu’où un homme peut-il aller pour un idéal ? »
Portraits de femmes
Aux esprits qui vacillent dans cet inextricable maelström géopolitique répond l’inébranlable pouvoir des femmes. Ce sont elles qui, dans les plis et recoins de leurs cœurs, conservent intact le parfum d’un Irak rêvé. Gardiennes des mémoires, ces femmes « écoutent sans juger, transmettent sans trahir », à l’exception de quelques effets de dramatisation qui transforment ces conteuses hors pair en faussaires assumées. Ces héroïnes du quotidien, qui supportent, souffrent et avancent malgré tout, cachent dans leurs silences des trésors inestimables. Figure tutélaire, autant crainte qu’admirée, Bibi Nahda, la mère d’Adel, est un personnage fascinant. Femme instruite et visionnaire, elle n’a jamais cessé « d’élargir son territoire intérieur par l’écriture et la lecture ». Emplissant les pages de ses carnets de pensées et idées, elle n’a eu de cesse « d’y imaginer un futur plus juste et plus éclairé » pour ses enfants tant aimés. « Pionnière silencieuse », elle n’a pas hésité à prendre, « sur les champs de bataille loin du front », les seules armes à sa disposition : les mots. Courageuse, fière et déterminée, elle a tissé une toile d’influence étonnante lui donnant une aura presque magique, laissant à chacun le loisir de croire, que derrière les volutes de ses cigarettes fumées à l’excès, se cachaient les flocons d’une neige qu’elle seule avait le pouvoir de faire tomber à Bagdad.
Identité et transmission
Cette histoire familiale, c’est Taymour qui nous la raconte. Celui dont le nom signifie « volonté de fer », petit-fils de Bibi Nahda et neveu d’Adel, se voit comme « le dissident familial ». Lorsque le roman s’ouvre, Taymour s’apprête à participer à une émission de télévision russe pour « tenter de reconstituer un puzzle dont certaines pièces se sont égarées entre deux mondes, l’Irak et l’Union Soviétique ». La grande force du roman réside dans la tension créée par l’alternance entre les époques, entre un présent où un Taymour angoissé est peut-être sur le point de percer l’un des plus grands mystères familiaux, et un passé qui dessine les contours d’une vie destinée à capturer, transmettre et témoigner. Dès l’enfance, Taymour n’a jamais voulu jouer cette comédie du mensonge, posant et reposant inlassablement les mêmes questions pour tenter de « trouver l’homme derrière la légende », noircissant les pages de ses carnets pour espérer enfin « disséquer l’absence » de cet oncle disparu dont le nom « résonne dans son esprit telle une symphonie d’épopées », lui le Français de naissance mais l’Irakien de cœur. La découverte du récit familial se mêle à celle d’un pays dont les parfums comme les traditions ne cessent de le surprendre. Sa position d’observateur extérieur associée à la fougue de sa jeunesse lui donne le courage de « suivre ces souterrains qui mènent de l’autel familial à ce mythe que l’on ne doit pas toucher ». Arpentant les chemins dessinés par sa « géographie de la résistance », Taymour finit par dessiner les contours de sa propre identité, choisissant de faire tomber « le masque que l’on ajuste au gré des regards » pour trouver enfin ce « reflet porteur de sens, ce fil invisible reliant ce qu’il avait été, ce qu’il était et ce qu’il voulait devenir ». Composant avec cette histoire et cette mémoire dont il est le dépositaire, se confrontant au dilemme de la vérité et de ses conséquences, Taymour, double fictionnel du romancier, continue à avancer avec la certitude que « chaque souvenir exprimé porte en lui la promesse d’une rédemption ».
Juliette Courtois
(c) Philippe Matsas